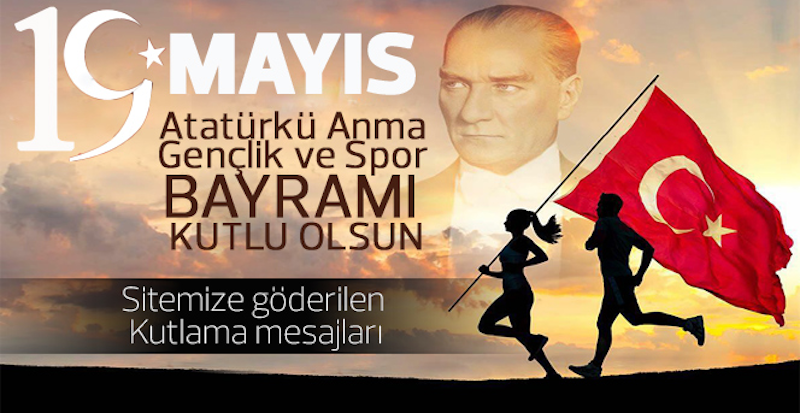L’Almanach international
Parce que chaque jour est important quelque part dans le monde
14 juin : jour de deuil dans les républiques baltes
C’est jour de deuil dans les trois républiques baltes en mémoire des déportations opérées à partir du 14 juin 1941, il y a 80 ans jour pour jour par les autorités soviétiques.
C’est jour de deuil dans les trois républiques baltes en mémoire des déportations opérées par les Soviétiques à partir du 14 juin 1941, il y a 80 ans jour pour jour.
Ce jour-là, et au cours des trois jours qui suivirent, quelque 10 000 Estoniens, des familles entières, principalement des citadins, furent déportés vers la Sibérie dans des conditions atroces, au point qu’une partie d’entre eux sont morts avant d’arriver à destination. Les familles étaient divisées : les hommes furent majoritairement emprisonnés dans des camps en Sibérie d’où très peu sont revenus alors que les femmes et enfants furent emprisonnées à Kirov, Tomsk, Omsk, Novossibirsk, Krasnovarsk ou encore dans le Krai de l’Altaï. Quelques semaines plus tard, d’autres vagues de déportations ont eu lieu et concernent encore plusieurs milliers de personnes. C’est ce triste anniversaire que les Estoniens célèbrent par un jour de commémoration annuel appelé leinapäev.
Les Lettons déplorent la même tragédie : dans la nuit du 13 au 14 juin, ce sont plus de 5 000 citoyens qui ont été déportés. Le 14 juin est célébré chaque année comme le Jour de la commémoration des victimes de la terreur communiste (Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā).
En Lituanie, cette date est appelée Jour de deuil et d'espoir (Gedulo ir vilties diena). Elle est jalonnée de cérémonies solennelles et de manifestations en mémoire des 18 500 déportations de cette sinistre journée… Au total, pour cette seule journée du 14 juin 1941 et lors des jours qui suivirent, en Lettonie, en Estonie et en Lituanie ce sont plus de 43 000 Baltes parmi lesquels plus de 3 000 enfants, qui sont déportés en Sibérie. Une majorité y laissera leur vie.
Selon le pacte Ribbentrop-Molotov du 23 août 1939 signé par les dictateurs allemands et soviétiques, les deux États totalitaires se partageaient l’Europe ce qui ouvrait la voie à une occupation soviétique des républiques baltes en octobre et novembre 1939. Ensuite, le 22 juin 1941, le Troisième Reich allemand envahit l'URSS et occupe en quelques semaines les territoires baltes, mettant fin aux déportations vers la Sibérie et d’autres exactions encore plus terribles les remplaceront très vite. Sous l’occupation allemande, des centaines de milliers d’autres Baltes seront déportées ou tués, principalement des juifs exterminés par les nazis ou par des milices baltes dans le cadre de la Shoah. En 1944, l’URSS va ensuite réoccuper les républiques baltes pour un demi-siècle et reprendre de plus belle les déportations vers la Sibérie. Celles-ci dureront jusqu’en mars 1949 et concerneront encore 90 000 personnes. Les commémorations du 14 juin les concernent aussi.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 juin 2021
11 juin : jour de mémoire au Canada pour les enfants autochtones enlevés à leur famille
Chaque année le 11 juin le Canada honore la mémoire des 150 000 enfants autochtones qui ont été enlevés de force de leur foyer pour être placés dans des pensionnats indiens à partir des années 1870 jusqu’au milieu des années 1990.
Chaque année, le 11 juin, le Canada honore la mémoire des 150 000 enfants autochtones qui ont été enlevés de force de leur foyer pour être placés dans des pensionnats indiens à partir des années 1870 et jusqu’au milieu des années 1990.
« Nos rêves comptent aussi », c’est le nom de la campagne que mène tous les ans, à cette même date, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des premières nations du Canada (autrement dit des autochtones). Enfants et adultes sont incités à adresser au Premier ministre ou au député de leur circonscription une lettre réclamant l’équité culturelle pour les enfants des populations amérindiennes. D’autres organisent des marches de soutien à cette campagne.
Tout a commencé un 11 juin 2008 lorsque le Premier ministre Stephen Harper a pris la parole à la Chambre des communes afin de présenter des excuses aux autochtones pour le grave préjudice subi par certains d’entre eux, envoyés de force dans des pensionnats. En effet, dès le but du XXe siècle, le système retirait les jeunes enfants autochtones de leur famille et les envoyait dans des établissements, souvent éloignés de leur communauté, afin de les isoler de leur famille et de leur culture en vue de les forcer à s’assimiler à la culture dominante. Depuis, chaque année, le Canada célèbre le 11 juin au titre de la Journée nationale de réconciliation. Un jour férié est à l’étude a annoncé Justin Trudeau…
La découverte, le 28 mai 2021, des ossements de 215 enfants autochtone enfouis dans une fosse commune d’un ancien pensionnat pour autochtones à Kamloops (Colombie-Britannique), le plus grand qu’ait connu le Canada, a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Mal nourris, mal chauffés, mal soignés : les enfants autochtones mouraient souvent de maladies, notamment de la tuberculose, ou en tentant de s'enfuir des pensionnats, mais les archives sont la plupart du temps incomplètes ou manquantes. Créé en 1890 et géré par l'Église catholique puis par le gouvernement fédéral, le pensionnat de Kamloops a fermé ses portes en 1978. D'autres pensionnats, environ 140 au total, ont perduré jusqu'en 1996, année de fermeture du dernier d’entre eux. Déjà en 2015, une commission nationale d’enquête avait qualifié ce système de « génocide culturel ».
Mise à jour : en 2021, cette journée a été déplacée au 30 septembre
9 juin : l’archipel des Åland célèbre un siècle d’une autonomie modèle
Ce jour est férié dans l’archipel suédo-finlandais en souvenir du 9 juin 1921 quand fut signé son statut d’autonomie, lequel n’a été effectif que le 9 juin 1922.
Ce jour est férié dans l’archipel en souvenir du 9 juin 1921 quand fut signé son statut d’autonomie, lequel n’a été effectif que le 9 juin 1922. Le Jour de l’autonomie (Självstyrelsedagen) est fêté chaque année. Mais en 2021 et jusqu’en 2022, on en célèbre le centenaire par une série de manifestations qui débute aujourd’hui.
Ce petit archipel de la mer Baltique aurait pu être l’objet d’une guerre entre la Suède et la Finlande. Il n’en a rien été et le statut d’autonomie qui lui a été accordé, il y a exactement 100 ans, pourrait servir de modèle à la résolution d’autres conflits dans le monde.
Ces îles sont peuplées de Suédois, c’est un morceau de la Suède qui s’est trouvé rattaché à la Finlande quand la Russie a mis la main sur le Duché de Finlande au début du XIXe siècle. Celui-ci était jusque-là une dépendance de la Suède. Cette dernière ne pouvant défendre ces îles face aux prétentions russes les a expressément cédées au Grand-Duché de Finlande, par le traité de Fredrikshamn de 1809.
L’Empire russe s’est effondré en 1917 et la Finlande en a profité pour proclamer son indépendance dès le mois de décembre 1917. Les républiques baltes et caucasiennes, ainsi que la Pologne ont fait de même en 1918. Aussitôt les habitants des îles Åland ont demandé à être rattachés à la Suède. Refus de la Finlande tout juste indépendante de se voir amputée d’une partie de son territoire. La tension est montée entre les deux pays. Finalement l’affaire a été portée devant la Société des nations (SDN), l’ancêtre de l’ONU. Pour régler la crise, la SDN a accordé une large autonomie aux Åland, mais dans les frontières de la Finlande (où l’archipel est appelé Ahvenanmaa). L’accord a été signé le 9 juin 1921.
Ce statut d’autonomie érigé en modèle prévoit des droits linguistiques et de la culture minoritaire, de démocratisation et de démilitarisation. Åland est la seule région de Finlande avec une seule langue officielle (le suédois), alors que le reste du pays est bilingue (finnois et suédois). Åland peut mettre son veto à toute modification de la répartition des pouvoirs entre Åland et le gouvernement central de Finlande. Le consentement du Parlement d'Åland est également requis pour les accords internationaux affectant les pouvoirs inhérents de la province ; par exemple, il a fallu son accord pour l'adhésion de la Finlande à l’UE en 1995. La citoyenneté régionale, qui est une condition préalable à la propriété foncière et à l'exercice d'une activité commerciale, est réservée exclusivement aux personnes résidant en permanence à Åland… Voilà un modèle qui aurait pu servir pour régler la question du Haut-Karabagh ou celles du Cachemire, de la Palestine occupée, de l’Irlande du Nord…
Les célébrations du centenaire s'étendent sur toute une année. Le point culminant est l'ouverture d'un centre d'accueil dans la forteresse historique de Bomarsund qui fut le théâtre d'un bombardement, en 1854, pendant la guerre de Crimée par une flotte anglo-française de la garnison russe.
Pour cette journée du 9 juin 2021, un hommage est rendu au premier président d'Åland, Julius Sundblom, près de sa statue sur la place, et une séance spéciale se déroule dans la salle plénière du Parlement, où des bourses sont attribuées dans le cadre du 75e anniversaire du Fonds d'autonomie d'Åland. À 17h30, Le drapeau des îles d'Åland sera hissé à Carlsro avec un chant traditionnel länningens sång. Peu de temps après, le groupe de jazz Red Beans and Rice se produira et tout le monde est invité à danser dans le jardin. De nombreuses œuvres d'art, photos, expositions et événements sur le thème d'Åland. Le concert d'ouverture sera diffusé sur la station de radio et la chaîne de télévision locales (Ålands radio et Ålandskanalen).
Parmi les rendez-vous du centenaire : 15-18 juillet : l’Opéra Lisbeta ; 22-25 juillet : une course de grands voiliers ; 17-19 septembre : la fête des vendanges (le climat plus doux que sur le continent permet de cultiver la vigne). Des concerts, des expos, des prix littéraires…
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 8 juin, 2021
Åland Post célèbre le centenaire avec l'émission d'un nouveau timbre le 9 juin 2021, conçu par Jonas Wilén.
6 juin : la fête nationale de la Suède
Les Suédois fêtent le retour de leur pays à l’indépendance en 1523. Ils étaient tombés sous la coupe du Danemark à la fin du XIVe siècle et ne supportaient d’être dirigés depuis Copenhague depuis la mise en place de l’Union de Kalmar en 1397.
Les Suédois fêtent le retour de leur pays à l’indépendance en 1523. Ils étaient tombés sous la coupe du Danemark à la fin du XIVe siècle et ne supportaient d’être dirigés depuis Copenhague depuis la mise en place de l’Union de Kalmar en 1397. C’est un certain Gustav Vasa aidé des habitants de la Dalécarlie, qui a entrepris les 1521, la reconquête du pays. La fameuse course de ski de fond, la Vasaloppet raconte le début de cette aventure. La bataille contre l’armée du roi Christian de Danemark a duré deux ans et demi. Finalement, le 6 juin 1523, lors d'une assemblée nationale réunie à Strängnäs, Gustav Eriksson Vasa a été élu roi d'une Suède, désormais libre. La date du 6 juin a été choisie en 1983 comme fête nationale de la Suède, car ce jour est celui de la naissance de la Suède telle qu’on la connaît aujourd’hui.
La fête a été créée en 1916 sous le nom de Jour du drapeau. Le 6 juin n’est fête nationale de la Suède (Nationaldagen) que depuis 1983 et n’est férié que depuis 2005, en remplacement du lundi de pentecôte. Un changement qui n’a pas été accepté par les syndicats suédois. Le 6 juin peut tomber périodiquement le week-end, tandis que le lundi de Pentecôte est toujours le lundi. Cela a conduit à moins de jours de congé certaines années. La solution a été trouvée en donnant à chacun un jour de congé supplémentaire, qui peut être utilisé à tout moment de l'année.
Le 6 juin est aussi l’anniversaire de la constitution de 1809, l’une des plus anciennes constitutions écrite du monde. Ce jour-là, le Riksdag adoptait la forme de gouvernement qui a jeté les bases de la Suède moderne (ce régime dure jusqu’en 1974). En ce jour de fête nationale (Nationaldagen), le palais royal à Stockholms est ouvert au public pour une visite. Le soir à 20 heures le roi prononce son discours, diffusé en direct sur SVT 2. La fête nationale de cette année est célébrée dans le parc de Skansen, mais, en raison de la pandémie, à une échelle plus petite que celle à laquelle on est habitués. Des petits drapeaux suédois sont distribués à tous les enfants, dans le hall supérieur de l'escalator se trouve l'exposition du Riksdag sur la démocratie et chacun a la possibilité de fabriquer sa propre couronne. C’est à Skansen que fut célébré en 1916, la première fête du drapeau suédois.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 juin 2021
photo : Frankie Fouganthin
5 juin : le jour est férié en Guinée équatoriale pour l’anniversaire du dictateur
C’est le plus ancien président en exercice au monde qui fête aujourd’hui son 79e anniversaire et bientôt (le 3 août) ses 42 ans de règne sans partage : Teodoro Obiang
C’est le plus ancien président en exercice au monde qui fête aujourd’hui son 79e anniversaire et bientôt (le 3 août) ses 42 ans de règne sans partage. Teodoro Obiang est arrivé au pouvoir en 1979 à la suite d’un coup d’État qui a mis fin à la dictature sanglante de son oncle (celui-ci avait commencé à décimer sa propre famille). Teodoro Obiang, bien sûr, est lui aussi un dictateur, son régime est l’un des plus oppressifs au monde. Le vice-président n’est autre que son fils aîné, Teodorin. Tous les autres postes à responsabilité sont détenus par des membres de la famille du président. Quant au chef de l’opposition, Severino Moto Nsa, réfugié en Espagne, il a été condamné à plus de 100 ans de prison par contumace. De quoi calmer les ardeurs d’autres candidats restés aux pays.
Le peuple de la Guinée équatoriale vit dans la misère mais la famille présidentielle mêne un train de vie fastueux. Sa fortune repose principalement sur le trafic international de drogue. Le président et son fils ont été notamment poursuivis en France, dans le cadre de l'enquête sur les “biens mal acquis”. En 2017, trois ans de prison, 30 millions d’euros d’amende et la confiscation des biens saisis ont été requis en juillet 2017 contre Teodorin Obiang.
Cette fête nationale du 5 juin a été créée pour célébrer l'anniversaire du président actuel de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, né en 1942. Chaque année, pour le Jour du président de la Guinée équatoriale (Día del Presidente de Guinea Ecuatorial), on organise un grand défilé dans le centre de Malabo, la capitale. La journée est chômée.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 4 juin 2021
3 juin : Mabo Day, le jour où le droit australien a fini par abolir la notion de Terra Nullius
L’Australie n’était pas inhabitée avant l’arrivée des Européens. Cette évidence historique n’a été reconnue qu’en... 1992, un 3 juin, par la Cour suprême de Canberra
L’Australie n’était pas inhabitée avant l’arrivée des Européens. Cette évidence historique n’a été reconnue qu’en... 1992, un 3 juin, par la Cour suprême. Jusque-là, prévalait la notion de « terra nullius », d’une terre qui n’appartenait à personne. Cette révolution juridique est le fruit de 10 ans de combats d’un Aborigène de l’île de Murray, dans le détroit de Torres, un certain Eddie Mabo.
Ce concept juridique, connu sous le nom de « terra nullius », a privé les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres de leurs droits traditionnels sur leurs terres et a tenté de rompre les liens avec des cultures remontant à 65 000 ans.
Eddie Mabo est décédé en 1992, environ six mois avant qu'on ne puisse voir les résultats de sa campagne. Son épouse, Bonita Mabo, a suggéré qu’un fête nationale, un Mabo Day, soit célébré le 3 juin 2002, à l'occasion du 10e anniversaire de la décision de la Haute Cour. En 2003, les commissions des aborigènes et des insulaires de Torres ont lancé une pétition pour faire du Mabo Day un jour férié en Australie. Et en 2010, une campagne a été lancée pour faire du 3 juin une fête nationale. Il commémore le jour où les non-autochtones ont eu la possibilité de réparer les dommages causés par la colonisation, ce jour devrait être plus important pour les Australiens que l'anniversaire de la reine.
Cette « Journée de Mabo » est fériée dans la région du détroit de Torres, pas encore dans toute l’Australie où l'on a encore du mal admettre cette réalité historique.
La décision Mabo a reconnu les droits traditionnels des peuples autochtones sur leurs terres et leurs eaux et a ouvert la voie au titre autochtone en Australie. Il a également reconnu que les peuples autochtones ont occupé l'Australie pendant des dizaines de milliers d'années avant l'arrivée des Britanniques en 1788. Le gouvernement australien a adopté le Native Title Act en 1993 après 52 heures de débat au Sénat, le débat le plus long de l'époque. La loi a établi le cadre permettant aux peuples autochtones de revendiquer un titre autochtone sur les terres de la Couronne. Cependant le Native Title Act comportait plusieurs conditions qui restreignaient la capacité des peuples autochtones à revendiquer des terres occupé en vertu d’un bail pastoral ou d'autres intérêts (minier notamment) qui sont réputés par la loi prévaloir sur le titre autochtone.
La décision Mabo a été, tout de même, saluée comme une victoire capitale pour les droits autochtones. Le Queensland avait tenté de s’en prémunir en adoptant, en 1985, la Queensland Coast Islands Declaratory Act. Cette loi abolissait rétroactivement toute revendication des insulaires sur l’espace maritime. Les gouvernements de plusieurs États ont demandé l'annulation du Native Title Act après qu'une série de revendications territoriales ont été déposées dans tout le pays, dont plusieurs ciblant les capitales.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 2 juin 2021
1er juin : la fête des enfants et... des parents
La journée de l’Enfance est particulièrement fêtée dans les anciens pays communistes. En particulier en Chine où ce jour-là les enfants n’ont pas classe, mais défilent dans les rues.
La Journée de l’Enfance est particulièrement fêtée dans les anciens pays communistes. Surtout en Chine où chaque 1er juin, les enfants n’ont pas classe et défilent dans les rues. Une loi chinoise de 2007 réserve cette fête aux moins de 14 ans. C’est aussi le cas en Corée du Nord, au Laos, en Mongolie, au Vietnam, en Éthiopie, en Birmanie, en Russie… où la journée est célébrées depuis 1950.
Cette Journée internationale de protection de l’enfant (International Day for Protection of Children), selon une autre appellation, vise à attirer plus d’attention sur la protection, l’éducation, la santé et le bien-être des enfants. Inspirée par une Conférence mondiale tenue à Genève, en 1925, autour de la protection de l’enfance, elle a véritablement été instituée par la Fédération démocratique internationale des femmes (FDIF), lors d’une réunion à Moscou en novembre 1949, pour rappeler le souvenir douloureux des enfants tués pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. En particulier les 88 enfants tués dans le village tchèque de Lidice, en juin 1942.
Quoi qu’il en soit, en 2012, l'Assemblée générale de l’ONU a décidé de proclamer le 1er juin, Journée mondiale des parents (World Parents Day), pour mettre à l'honneur les parents du monde entier. Sinon, le calendrier l’ONU propose lui aussi une Journée internationale des droits de l'enfant, fixée le 20 novembre.
Il existe aussi ne nombreuses fêtes nationales dédiées aux enfants : en Inde, au Népal, au Bangladesh, en Thaïlande, en Turquie, au Japon, à Singapour, en Allemagne, en Suède, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine… En Chine, le 1er juin a remplacé le 4 avril (adopté en 1932 et qui a toujours cours à Taïwan).
Officiellement, la Journée des enfants est célébrée le 1er juin dans les anciens États de l'Union soviétique : l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Estonie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine, l'Ouzbékistan ainsi que d'autres anciens ou États communistes actuels : Albanie, Angola, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cambodge, Croatie, Cuba, République tchèque, Slovaquie, Éthiopie , Kosovo, Laos, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Chine, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovénie, Tanzanie, Vietnam et Yémen, ainsi qu’en Israël au sein de sa population juive soviétique. Cela dit, dans beaucoup de ces pays la fête semble être tombée en désuétude. Mais pas partout, en Roumanie, par exemple, le 1er juin est même devenu un jour férié en 2017, sous le nom de Journée de l’enfance (Ziua Copilului). De nombreux musées leur ouvrent les portes chaque 1er juin pour des animations. Au Cap-Vert, on a élargi la cible, c’est la Journée de la Jeunesse (fériée), tout comme en Mongolie où c’est la Fête des mères et des enfants.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 1er juin 2021
31 mai : il y a 100 ans, à Tulsa, le plus terrible lynchage de Noirs de l’histoire américaine
Localement le massacre de Tulsa est célébré chaque 31 mai, cette année pour le centenaire du drame, le président des États-Unis se déplacera, il assistera demain à des cérémonies qui durent plusieurs jours.
Localement le massacre est célébré chaque 31 mai (Tulsa race massacre Day), cette année pour le centenaire du drame, le président des États-Unis se déplacera, il assistera demain à des cérémonies qui durent plusieurs jours.
Cela se passe à Tulsa, dans l’Oklahoma : le 30 mai 1921, un jeune Noir maladroit bouscule une jeune fille blanche, lui a-t-elle marché sur le pied ? L’a-t-il heurté ? On ne sait pas. Toujours est-il qu’elle pousse un cri, aussitôt on accourt croyant une agression. Le jeune homme, qui sait ce qu’il risque, se réfugie à Greenwood, où habite sa mère. Il sera vite retrouvé et arrêté, mais la jeune fille refuse de porter plainte. L’affaire aurait dû en rester là, si un groupe d’hommes noirs patrouillant devant le commissariat pour protéger le jeune garçon, n’était pas tombé nez à nez avec un groupe d’hommes blancs hystériques réclamant le lynchage du coupable. Des coups de feu sont partis, on comptera plusieurs victimes surtout des Blancs. Aussitôt la ville s’enflamme contre le quartier noir de Greenwood, un quartier relativement prospère où vivait une classe moyenne supérieure noire qui suscitait bien des jalousies dans cette petite ville du vieux Sud. Le quartier était même connu sous le nom de Black Wall Street, en référence au quartier des affaires de New York. Les pillages et destructions durent deux jours à partir du 31 mai 1921. 1256 maisons sont détruites, plus de 10 000 personnes, quasiment toutes afro-américaines, se retrouvent à la rue. 300 morts sont comptabilisés mais le nombre des victimes serait bien plus important. Du quartier, il n’est rien resté : des avions d’agriculteurs de la région ont même été mobilisés pour déverser des produit inflammable sur les bâtiments : école, hôpital (le seul qui accueillait les Noirs), églises, entreprises… tout à disparu en quelques heures. Personne, bien sûr, n’a été poursuivi, la mémoire collective a très vite effacé le drame.
Il a fallu attendre 2001 , pour que l’État fédéral d’Oklahoma a passé une loi intitulée « 1921 Tulsa Race Riot Reconciliation Act » pour accéder quelques réparations symboliques aux descendants des victimes comme la distribution de 300 bourses d’études supérieures à des familles brisées. En 2011, un mémorial est créé et baptisé John Hope Franklin, un historien afro-américain originaire de Tulsa. Finalement en 2021, le pogrom commence à mobiliser les autorités fédérales, puisque Joe Biden sera présent aux cérémonies.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 31 mai 2021
29 mai : Royal Oak Day, une ancienne tradition monarchiste anglaise
C’est Royal Oak Day (ou Oak Apple Day) fut jadis un jour férié en Angleterre. Il commémorait la restauration de la monarchie le 29 mai 1660. Ce n’est plus jour férié officiel, mais il est toujours célébré de manière informelle dans certaines régions du pays.
C’est Royal Oak Day (ou Oak Apple Day) fut jadis un jour férié en Angleterre. Il commémorait la restauration de la monarchie le 29 mai 1660. Ce n’est plus jour férié officiel, mais il est toujours célébré de manière informelle dans certaines régions du pays.
Le port d'un brin de chêne (oak) à la boutonnière permettait de montrer que l’on était fidèle à la monarchie (restaurée en 1660). Certains monarchistes traditionalistes le font encore de nos jours pour Restauration day, le 29 mai.
On raconte, en effet, qu’en 1651, pendant la guerre civile anglaise, le futur Charles II d'Angleterre réussit à échapper aux troupes parlementaires de Cromwell, en se cachant dans un chêne du bois de Boscobel. On dit qu’un soldat parlementaire serait même passé sous l'arbre sans le remarquer. L'arbre sera honoré plus tard du titre de “chêne royal”. Après la restauration de la monarchie, le Parlement avait déclaré le 29 mai, jour anniversaire du roi (il est né le 29 mai 1630), jour férié officiel, nommé Royal Oak Day ou Oak Apple Day en mémoire de la cachette du futur roi.
De nos jours, il est traditionnel pour les monarchistes de décorer leur maison avec des branches de chêne ou de porter un brin de chêne le 29 mai. Dans l'église All Saints de Northampton, une guirlande de pomme de chêne (oak apple), en fait la galle du chêne, est posée sur la statue de Charles II. Ce jour-là, il est de tradition de manger du pudding aux prunes. C’est le cas, en particulier au Royal Hospital de Chelsea, fondé par Charles II, un 29 mai, pour héberger les pensionnaires de l’armée. La Parade des pensionnaires de Chelsea a lieu ce même jour.
Chaque 29 mai, des événements ont toujours lieu à Upton-upon-Severn, dans le Worcestershire, à Marsh Gibbon, dans le Buckinghamshire, à Great Wishford, dans le Wiltshire (les villageois ramassent du bois dans la forêt de Grovely), à Aston-on-Clun, dans le Shropshire et à Membury, dans le Devon. La journée est généralement marquée par une reconstitution historique au Moseley Old Hall, dans les West Midlands, où subsiste l'une des maisons où Charles II s'est caché en 1651.
St Neot, village de Cornouaille, un 29 mai
À Fownhope, dans le Herefordshire, la Heart of Oak Society organise un événement annuel, où les membres de la société se rassemblent au pub local et défilent dans le village en tenant des bâtons décorés de fleurs et de feuilles de chêne, tout en suivant la bannière de la société et une fanfare. La marche se rend d'abord à l'église pour un service, puis aux maisons qui accueillent des rafraîchissements. La fête a connu un succès croissant ces dernières années. En 2021, des célébrations sont également prévues devant l'ancienne maison de Charles II du château de Windsor à Eton WIck.
Par tradition, les enfants mettaient chacun au défi de montrer son brin de chêne, faute de quoi, on se faisait pincer le derrière. C’est pour cela que ce jour est aussi connu sous le nom de Pinch-Bum-Day. Dans certaines régions d'Angleterre où les glands sont connues sous le nom de shick-shacks, le 29 mai est le Shick-Shack Day… les ethnologues y voient le maintient d’une une tradition païenne de culte des arbres à laquelle on aurait donné une nouvelle signification pour la rendre plus acceptable. C’est sans doute la raison de sa survie alors que le jour férié du Royal Oak Day a été aboli en 1859.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 28 mai 2021
28 mai : le Pakistan célèbre le jour où il est devenu une puissance nucléaire
Journée de la grandeur ou Youm-e-Takbir, au Pakistan commémore les essais nucléaires de 1998 qui ont fait du Pakistan le septième pays à posséder des armes nucléaires et le premier du monde musulman.
C’était le 28 mai 1998, sur la base de Chagai, au Balouchistan, le gouvernement pakistanais dirigé par Nawaz Sharif, procédait à cinq essais nucléaires réussis. Le Pakistan répondait ainsi à une deuxième série d’explosions nucléaires opérée par l’Inde les 11 et 13 mai. Le Pakistan essuya quelques protestations, très formelles, de la par des Occidentaux. Étonnement, le pays n’a fait l’objet d’aucune sanction ni entraves depuis la mise en route de son programme nucléaire dans les années 1970. On ne peut pas dire que ce pays, qui a servi de refuge à Ben Laden, soit beaucoup plus rassurant pour les intérêts occidentaux que l’Iran. Ni que son opinion publique soient beaucoup plus tolérante à l’égard des modes de pensée autres qu’islamiste. Toujours est-il qu’il a été aidé techniquement par la Chine et financièrement par l’Arabie saoudite, autre protégé des États-Unis. Le but était de contrer l’Inde, qui était plutôt une cliente de l’URSS. Le Pakistan fut un outil des États-Unis dans sa lutte contre le communisme, d’où l’indulgence de Washington. Sauf qu’en 1998, l’URSS avait disparue depuis longtemps et que toute manière l’Inde n’a jamais été un satellite de Moscou et n’a jamais menacé l’Occident. Il a fallu le 11-Septembre pour que les Américains comprennent leur erreur. Un peu tard.
Le 28 mai 1998, le Pakistan est devenu la première puissance nucléaire du monde islamique et la septième au monde après les États-Unis, la Fédération de Russie (héritière de l’Union soviétique), la Grande-Bretagne, la France, la Chine et l'Inde. C’est cet événement majeur que les Pakistanais célèbrent chaque 28 mai par un cri de guerre : Youm-e-Takbir ! C’est aujourd’hui la Journée de la grandeur ou Youm-e-Takbir ( یوم تکبیر ) au Pakistan. Une occasion pour des discours patriotiques, des menaces à l’égard des voisins, des défilés militaires, remises de médailles… Chaque année, c’est l’occasion de rendre hommage à Abdul Qadeer Khan, le scientifique honoré du titre de « père de la bombe pakistanaise ». Quant au premier ministre de l’époque, Nawaz Sharif, emprisonné un temps pour corruption, il est célébré par les membres de son parti, la Ligue musulmane, dans l’opposition depuis 2018. S’il est l’auteur des essais, il n’est n’est pas l’initiateur du programme nucléaire pakistanais. Celui-ci a été lancé par Zulfiqar Ali Bhutto après la défaite de 1971 face à son voisin et surtout en réaction au programme nucléaire de l’Inde dont le premier essai remonte à 1974. Au lendemain du 28 mai 1998, les responsables iraniens se sont tournés vers la France pour qu’elle poursuive son aide à un programme nucléaire qu’elle avait initiée. En vain, on sait avec quelle véhémence les États-Unis se sont opposés à une telle idée, à laquelle de toute manière la France n’aurait pas cédé tant que ce pays demeure une théocratie. Le programme nucléaire du Pakistan, pays dont la connivence avec le terrorisme islamiste n’est plus à démontrer, n’a jamais été l’objet d’un débat international si on le compare à celui qui hystérise le monde à propos de l’Iran. Depuis la région s’est dotée d’une autre puissance nucléaire, en toute discrétion et dans l’illégalité, celle d’Israël. Un autre non sujet de l’actualité internationale.
En vignette, apparaissent Abdul Qadeer Khan, le père de la bombe et Nawaz Sharif, l’auteur des essais
Des militantes de la Ligue musulmane rendant hommage à Nawaz Sharif, l’auteur des essais nucléaires
27 mai : sur fond de montée de l’extrême droite, la France célèbre la Résistance et son héritage : le modèle social français
Depuis 2013, le 27 mai est la Journée nationale de la Résistance. Ce n’est pas un jour férié mais une célébration d’homme et de femmes qui, pour certains, ont donné leur vie pour vaincre le fascisme. C’est aussi l’occasion de célébrer les acquis de la Résistance.
Depuis 2013, le 27 mai est la Journée nationale de la Résistance. Ce n’est pas un jour férié mais une célébration d’hommes et de femmes qui, pour certains, ont donné leur vie pour vaincre le fascisme. C’est aussi l’occasion de célébrer les acquis sociaux de la Résistance.
Le 27 mai marque la date de la première réunion du Conseil national de la Résistance (CNR), présidée par Jean Moulin, qui s'est déroulée le 27 mai 1943, rue du Four, à Paris.
Jean Moulin, préfet révoqué par le régime de Vichy, reçut du Général de Gaulle, au début de l'année 1942, la mission de rallier et d'unir les principaux mouvements de résistance afin de créer une véritable armée secrète œuvrant sur le territoire occupé par l'ennemi, sous une même autorité. C’est ainsi que furent réunis, dans un même lieu, au cœur de Paris occupé, les représentants des principaux mouvements de résistance français ainsi que des principaux partis politiques (radicaux, républicains, socialistes, communistes…) et syndicats (CFTC, CGT…) existant avant la guerre. Ensemble, ils allaient œuvrer à coordonner l’action de la Résistance et, dans la perspective de la libération du territoire national, à préparer la refondation de la République.
Le 15 mars 1944, après plusieurs mois de négociations, a été adopté, à l'unanimité, le programme du CNR. Il appelle à l'intensification de la lutte contre l'occupant et ses collaborateurs français, organisant l'insurrection armée, mais il jette également les bases d'une République nouvelle, profondément démocratisée, s'appuyant sur "un ordre social plus juste". La France de 2021 vit encore sur les créations du CNR : en premier lieu le régime général de la Sécurité sociale, les comités d'entreprise qui protège les salariés, la généralisation de l’assurance vieillesse, le statut de la Fonction Publique, le rétablissement de la semaine de 40 heures (passé à 35 heures un demi-siècle plus tard), la suppression de l'abattement de 10 % sur les salaires des femmes (même si l’égalité salariale n’est toujours pas atteinte), 3 semaines de congés payés (passé ensuite à 4 puis à 5)… Rien de tout cela n’existe dans un pays aussi prospère que les États-Unis. Le modèle français n’est pas unique mais n’existe que dans une dizaine de pays dans le monde. Et il convient de le défendre, c’est sur lui que repose le lien social français. Le 27 mai est une journée pour le rappeler à tous les blasés du système et autres gilets jaunes ignorants de ce qu’ils doivent à la Résistance.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 26 mai 2021
26 mai : la Géorgie célèbre son indépendance malgré l'occupation russe de deux de ses provinces
Chaque 26 mai, la Géorgie célèbre le Jour de l’indépendance, en souvenir de l'adoption, le 26 mai 1918, de l'acte d'indépendance, qui a créé la première république démocratique de Géorgie, après un siècle de domination russe.
Chaque 26 mai, la Géorgie célèbre le Jour de l’indépendance (დამოუკიდებლობის დღე ), en souvenir de l'adoption, le 26 mai 1918, de l'acte d'indépendance qui a créé la première république démocratique de Géorgie, après un siècle de domination russe. Cette date est celle la fête nationale géorgienne. Sa célébration fut interdite de 1922 à 1991.
Une indépendance qui pourtant ne dure pas : le 25 février 1921, la Géorgie a été conquise par l’Armée rouge et sera un peu plus tard intégrée à l’URSS, et le restera jusqu’en… 1991. Le 31 mars 1991, un référendum sur la base de l'Acte d'indépendance du 26 mai 1918, décidait à nouveau de l’indépendance du pays. La petite Géorgie ne sera pas débarrassée des Russes pour autant. L’armée russe, sans que les autres nations européennes n’y trouvent à redire, occupe aujourd’hui l'Abkhazie dont Moscou a provoqué la sécession en 1993. Quinze ans plus tard, c’est au tour de l’Ossétie du Sud de subir le même sort. Mal inspiré, le président français Sarkozy qui présidait alors l’Union européenne, s’est déplacé en personne à Moscou pour permettre à Poutine de transformer sa victoire militaire sur la Géorgie en une victoire politique. Depuis le 26 août 2008, la situation est bloquée. Ces deux territoires échappent totalement à la tutelle de la Géorgie. C’est donc un pays largement amputé qui célèbre aujourd’hui son indépendance.
En 2021, la Géorgie célèbre également le 100e anniversaire de l'occupation soviétique mais tout en fêtant les 30 ans du rétablissement de l'indépendance du pays (au printemps 1991). La célébration du jour de l'indépendance se déroule sur la place de la Liberté dans la capitale géorgienne de Tbilissi fermée pendant six jours pour les festivités. L’an dernier tout avait été annulé pour cause de pandémie, on va se rattraper cette année.
Les célébrations de la fête nationale en Géorgie sont traditionnellement marquées par des discours et des cérémonies politiques, des levées du drapeau national, des concerts et des festivals, des foires et des expositions et à d'autres événements publics célébrant la riche histoire et la culture du pays. Une célébration particulièrement importante, avec plus de 20 délégations de haut niveau présentes, avait eu lieu en 2018 à l'occasion du centenaire de l'indépendance. L’Arménie et l’Azerbaïdjan célèbrent le même anniversaire de l’indépendance le 28 mai.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 25 mai 2021
25 mai : la Jordanie fête ses 75 ans d'indépendance, incroyable longévité d’un pays inventé
La Jordanie célèbre son indépendance acquise en 1946, le 25 mai. C’est sa fête nationale.
La Jordanie célèbre chaque 25 mai, son indépendance (عيد الإستقلال ) acquise en 1946, le 25 mai, il y a 75 ans jour pour jour. Ce petit territoire inventé par les Anglais n’avait pas vocation à devenir un État, juste une zone tampon. Non seulement, il en est devenu un sans aucune profondeur historique mais il a survécu à toutes les crises et occupation de territoire qui ont marqué la région.
Il y a un siècle, bien peu auraient parié sur l’avenir politique de ce territoire inventé par les Anglais pour de simples raisons conjoncturelles. Le pays ne repose sur aucune réalité historique hormis de majestueuses ruines antiques dont le souvenir s’était totalement perdu. Ce bout de désert délimité par les Britanniques n’abritait au début du XXe siècle que quelques bourgades de quelques milliers d’habitants et des tribus bédouines nomades et réfractaires à l’idée de frontière. Aucune richesse connue à l’époque et aujourd’hui encore.
Pendant la Première guerre mondiale, Français et Anglais avaient fait la promesse aux élites locales de la création d’un grand royaume arabe bâti sur les décombres de l’Empire ottoman (alors alliés à l’Allemagne). Hussein, le chérif de La Mecque, de la famille des Hachémites, se voyait déjà le monarque de cet État qui aujourd’hui, grâce au pétrole, serait devenu une puissance incontestable.
On le sait, la promesse n’a pas été tenue. Elle ne devait, de toute manière, pas l’être puisque Français et Anglais se sont partagé secrètement la région dès 1916 (accords Sykes-Picot). La Syrie aux Français, tout le reste aux Anglais.
À l’époque, ce petit pays a été baptisé Transjordanie, un nom inventé pour l’occasion car, vu de Jérusalem où étaient établis les Anglais, ce territoire était situé de l’autre côté du fleuve Jourdain. En 1950, la Cisjordanie viendra agrandir le royaume qui désormais s’appellera Jordanie. On le sait, depuis 1967, la Cisjordanie est occupée par Israël, mais le pays réduit aujourd’hui à son territoire d'origine a conservé son nouveau nom.
Pourquoi avoir ainsi inventé un pays ? Ce territoire n’était, de fait, pas destiné en devenir un. Londres voulait juste créer un espace tampon pour stabiliser la géopolitique régionale et contenir les ambitions des uns et des autres. Devenant un petit royaume, cette zone tampon a parfaitement joué son rôle. Pour les Anglais, il fallait d’abord, borner le mandat britannique par rapport à celui des Français. Depuis Damas, ces derniers pouvaient avoir des visées sur la région. Il convenait d'occuper le terrain. Ensuite, il fallait surtout empêcher un éventuel royaume arabe dont l’idée n’était pas totalement abandonnée, d’atteindre la Méditerranée. Mais aussi aux juifs à qui les Anglais avaient promis un territoire de ne pas se répandre au-delà du Jourdain… La Jordanie a eu toutes ces fonctions à la fois et les assume encore aujourd’hui en dépit des évolutions du contexte géopolitique.
Le logo officiel de 2021
Ce petit royaume n’a quasiment eu que trois monarques en un siècle : d’abord Abdallah, fils d’Hussein de La Mecque à qui on a donné le trône en guise de consolation de la promesse non tenue d’un grand Royaume arabe. Puis Hussein, petit-fils du précédent et enfin son fils, Abdallah II. Et le prince héritier actuel, vous l’aviez deviné, il est prénommé Hussein. La fête de ce jour est aussi celle de la famille Hachémite, dont le roi de Jordanie est le dernier représentant sur un trône depuis qu’ont été perdus La Mecque, au profit des Séoud et l’Irak, devenu une république. On dit qu’elle serait la deuxième plus ancienne dynastie au monde, après celle qui règne sur le Japon. Les responsables locaux, civils et militaires, viennent lui rendre hommage. La journée est aussi consacrée à la remise de prix, à des visites de diplomates. Puis, tout le monde assiste à la levée des couleurs et au défilé militaire qui s’achève sur le tir de 21 coups de canon. La soirée est plus festive et se termine par un feu d’artifice.
L’indépendance de la Jordanie est le fruit du traité de Londres signé le 22 mars 1946, il a fallu toutefois encore deux ans pour que la Jordanie soit pleinement indépendante, en mars 1948, quand la Jordanie l'a signé la Grande-Bretagne un autre traité dans lequel toutes les restrictions à la souveraineté ont été supprimées pour la Jordanie être totalement indépendant. Cette année, le royaume de Jordanie fête ses 100 ans, il lui a fallu un quart de siècle pour parvenir à l’indépendance. Les Anglais n’ont si facilement lâché leur création.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 24 mai 2021
Photo de Muath Freij
Le 25 mai 1946, au centre le roi Abdallah et derrière lui son petit-fils Hussein
23 mai : le journée nationale des Valaques ou Aroumains, peuple oublié des Balkans
La Macédoine du nord, peuplée de Slave et d’Albanais est le seul pays à avoir créé, en 2007, un jour férié en l’honneur du peuple Valaque ou Aroumain. Cette fête existe néanmoins depuis 1991, c’est aujourd’hui sa 30e édition.
La Macédoine du nord, peuplée de Slave et d’Albanais, est le seul pays à avoir créé un jour férié en l’honneur du peuple Valaque ou Aroumain. Depuis 2007, le ministère du Travail accorde un jour de congé aux personnes appartenant à ce peuple, très minoritaire en Macédoine. Le 23 mai y est connu sous le nom de Journée nationale des Valaques (Национален ден на Властите, en macédonien) (Dzua Natsionalã a Armãnjilor, en aroumain ).
Les Valaques, tels qu’on les nomme en Macédoine et en Grèce, seraient quelque 250 000 éparpillés dans tous les Balkans et ailleurs en diaspora. Ce peuple de bergers ou de commerçants itinérants était jadis nomade ce qui explique sa dispersion. Aujourd’hui sédentarisés, ils se fondent dans les populations locales. Leur langue est latine, proche du roumain, aussi la Roumanie les considère comme des Roumains de la diaspora et les nomme Aroumains pour les distinguer. Ils ont aussi participé à l’histoire de la Grèce. Il y a 200 ans exactement, en 1821, commençait la guerre d'indépendance grecque et beaucoup des premiers combattants de l'indépendance (certains vivaient d’ailleurs en Roumanie) étaient eux-mêmes issus de la communauté aroumaine comme Rigas Velestinlis, Ioánnis Koléttis ou Giorgakis l'Olympiote. Mais, en Grèce, on affirme que les Valaques ne sont pas un peuple particulier, juste des Grecs latinisés que l’Empire ottoman a reconnus à tort comme un peuple.
La date du 23 mai fait en effet référence à la reconnaissance de la communauté aroumaine ou valaque comme nation (millet) par le sultan ottoman Abdul Hamid, le 23 mai 1905. Cette décision leur donnait droit au sein de l’empire à une éducation dans leur langue maternelle et à une autonomie religieuse. Au grand dam des Grecs qui, de fait, ne les fêtent pas le 23 mai.
C’est en 1991, il y a 30 ans exactement, que le 23 mai a été déclaré Journée nationale des Valaques du monde entier par la Ligue des Valaques et quelques autres associations valaques soucieuses de ne pas voir leur peuple s’effacer totalement du paysage du sud-est de l’Europe. Ce jour est principalement célébré par les Aroumains pro-roumains vivant en Albanie, en Bulgarie, en Macédoine du Nord et en Roumanie. En revanche, il n’est pas marqué en Grèce où pourtant, une localité du nord du pays, Samarine (Σαμαρίνα) se revendique comme capitale des Valaques. Ce village perdu est largement déserté aujourd’hui, mais des milliers de membres de la diaspora koutsovalaque (les Valaques du Pinde) s'y rassemblent autour du 15 août de chaque année. En Macédoine, c’est Krouchevo (Крушево), Crușuva en valaque, qui fait figure de capitale des Aroumains-Valaques. Ceux-ci ne représentent toutefois que 10% des habitants de la ville mais des médias en langue aroumaine y sont disponibles et des émissions régulières de télévision et de radio en langue aroumaine contribuent à assurer sa survie. Celle-ci est également enseignée à l’université en Macédoine du Nord.
Les Aroumains ou Valaques se désignent eux-mêmes comme Rrãmãn ou Armãn, selon le groupe dialectal auquel ils appartiennent, et s'identifient comme faisant partie du Populu Armãnescu (le peuple aroumain).
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 22 mai 2021
21 mai : le Monténégro fête ses 15 ans d'indépendance
Le 21 mai est l’une des deux fêtes nationales du Monténégro. C’est le Jour de l’indépendance (Dan nezavisnosti Crne Gore) obtenue en 2006 par référendum.
Le 21 mai est l’autre fête nationale du Monténégro, avec le 13 juillet, date de sa reconnaissance en 1878. Il y a 15 ans, le 21 mai 2006, 55,5% des Monténégrins votaient oui au référendum d’indépendance, soit une grosse moitié des électeurs. Une validation obtenue de justesse car le seuil exigé avait été fixé à 55%.
Les autres n’étaient pas partisans de faire disparaître la Yougoslavie, où ce qu’il en restait (la Serbie, le Monténégro, le Kosovo et la Voïvodine) car la fédération avait déjà perdu la moitié de ses membres. Les uns étaient nostalgiques de la grande Yougoslavie, ce pays qui comptait dans le monde ; les autres se considéraient comme serbe et donc ne voulaient être séparés de la mère patrie, en dépit des errements aux cours des années qui ont précédé. Dans la soirée du 3 juin 2006, le Parlement du Monténégro proclame donc officiellement l’indépendance du pays et la dissolution de la communauté de Serbie-et-Monténégro, le nom que portait au final le dernier avatar de la Yougoslavie. Le pays sera très vite reconnu par la communauté internationale et entrera à l’ONU, le 28 juin 2006. Dernier pied de nez, involontaire, à la Serbie dont le 28 juin est la date sacrée des nationalistes.
Milo Đukanović, le père de l’indépendance, qui dirigeait le pays depuis 30 ans, dont le gouvernement, très corrompu et peu démocrate, mais qui a œuvré à rapprocher le Monténégro de l’Occident a fini par être balayé par une coalition menée par Zdravko Krivokapić, pro-russe, pro-serbe et surtout proche de l’église orthodoxe serbe alors que l’ancien gouvernement avait encouragé la création d’une église orthodoxe nationale, non reconnues par les autres branches de l’orthodoxie. Milo Đukanović reste président, mais pour la première fois depuis 1990 doit cohabiter avec un gouvernement d’opposition. Il n’est pas sûr que la date du 21 mai, le Jour de l’indépendance (Dan nezavisnosti Crne Gore) soit célébrée comme elle l’était jusque-là.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 20 mai 2021
20 mai : la journée de l'éveil national indonésien
En Indonésie, c’est la Journée de l’éveil national (Hari Kebangkitan Nasional). Elle commémore la création du premier groupe nationaliste indonésien, Budi Utomo, le 20 mai 1908, alors que l’Indonésie n’existe pas encore.
En Indonésie, c’est la Journée de l’éveil national (Hari Kebangkitan Nasional). Elle commémore la création du premier groupe nationaliste indonésien, Budi Utomo, le 20 mai 1908, alors que l’Indonésie n’existe pas encore, même dans l’esprit de ses promoteurs. Ce n’est pas un jour férié, mais d’ordinaire des célébrations sont organisées un peu partout dans le pays, notamment dans les universités. Budi Utomo était à l’origine un groupe d’étudiants de bonne famille conduit par un médecin à la retraite, Wahidin Soedirohoesodo. En 1910, cette société plus culturelle que politique est officiellement reconnue par les autorités coloniales. À l'époque, elle comptait environ 10 000 membres. Il faudra toutefois attendre, toutefois, les années 1920 pour que ses membres s’identifient comme indonésiens (et non javanais, balinais,…) et que naisse un parti indépendantiste, le Parti national indonésien fondé en 1927 par Soekarno.
Occupé depuis le XVIIe siècle par des Hollandais, l’archipel a été une colonie néerlandaise officielle à partir de 1800. À l’issue d’une occupation japonaise de 3 ans, les leaders nationalistes ont proclamé l’indépendance de leur pays. Les Pays-Bas mettront 4 ans à admettre l’indépendance de leur ancienne possession. Celle-ci comme ailleurs a été acquise à l’issus d’une guerre d’indépendance qui avait pris la forme d’une guérilla. C’est toute cette mémoire qui resurgit chaque 20 mai.
C’est le président Soekarno, en 1948, qui a choisi la date du 20 mai. «Nous sommes une nation résiliente» est le thème de la journée cette année 2021, en référence à la crise sanitaire. Il est recommandé comme l’an dernier de célébrer en toute sécurité Harkitnas 2021 à la maison. On pourra suivre la cérémonie en ligne sur site de Kominfo : http://komin.fo/Harkitnas2021 . Faute d’autres manifestations, on peut tout en restant chez soi, voir ou revoir l’un des nombreux films historiques qui rappelle ce processus historique, à savoir : Guru Bangsa Tjokroaminoto (2015), Kartini (2017), Sang Pencerah (2010)…
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 19 mai 2021
19 mai : la Turquie célèbre Atatürk et sa guerre de libération
Chaque année le 19 mai, la Turquie célèbre Atatürk et fête sa jeunesse sportive. Cet anniversaire rappelle la date du 19 mai 1919, considère comme le début de la guerre de libération qui a conduit à la création de la Turquie actuelle.
Chaque année, le 19 mai, la Turquie célèbre Atatürk et fête sa jeunesse sportive. Ce jour férié rappelle la date du 19 mai 1919, que l’historiographie officielle considère comme le début de la guerre de libération qui a conduit à la création de la Turquie actuelle dont les contours n’avaient rien d’évident à l’époque. Ce pays a été construit au détriment d’autres peuples : Arméniens, Grecs, Kurdes… et au prix de terribles massacres.
L’Empire ottoman, vaincu de la Première Guerre mondiale, était en effet occupé par plusieurs puissances étrangères (Anglais, Français, Italiens…). À l’Ouest les Grecs avaient proclamé le rattachement de l’Asie mineure à la Grèce. À l’Est, une République d’Arménie existait depuis déjà un an. Les Kurdes réclamaient, eux aussi, un État… la Turquie était en train d’être complètement dépecée comme l’a été l’Empire austro-hongrois à la même époque. Ce qui restait du pays était en proie à une guerre civile qui opposait l’armée du sultan aux nationalistes. Un officier en rupture avec le pouvoir du sultan, Mustapha Kemal, s’embarque alors pour le port de Samsun, sur la mer Noire où il débarque le 19 mai, il entame la reconquête du territoire qui se terminera en 1922 par une terrible guerre qui se fera notamment au détriment des Grecs et des Arméniens. Les Européens laisseront se créer une Turquie puissante dans l’espoir qu’elle ferait barrage à une URSS devenue inquiétante, en lui offrant le traité de Lausanne (1923).
Cette journée du 19 mai est commémorée officiellement depuis 1938 sous le nom Journée de commémoration d’Atatürk, de la Jeunesse et des Sports (Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı) et des marches accompagnent sa célébration, connue sous le nom "marche de la jeunesse" (Gençlik marşı). Les principales célébrations ont lieu à Ankara, au mausolée d’Ataturk mais aussi à Samsun où des centaines de scouts et des milliers de personnes participent à une marche au flambeau après avoir rallumé la flamme de l’indépendance. Une cérémonie a également lieu devant le monument de la République à Taksim dans la ville d’Istanbul. C’est une de ces journées qui flatte le nationalisme turc et dont raffole Recep Tayyip Erdoğan, le despote turc qui se veut l’égal d’Atatürk.
Cette journée est dédiée à Mustapha Kemal, dit Atatürk, dont on fête aussi l’anniversaire. Il est né en 1881, mais on ne sait pas quel jour. Alors quoi de mieux que le 19 mai ? C’est ce jour-là, en 1919, qu’il est né, disait-il.
Le même jour, en Grèce, on commémore depuis 1994, la Journée du génocide grec (Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου) en mémoire de la mort des quelque 350 000 Grecs pontiques massacrés par les Turcs, dans les années 1915 à 1923. Les Arméniens ont également été victimes d’un génocide orchestré par les autorités ottomanes. Ils le commémores chaque 24 avril.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 18 mai 2021
18 mai : l'anniversaire d'un pays que personne ne connaît ni ne reconnaît, le Somaliland
Il y a 30 ans, le 18 mai 1991, un nouvel État tentait d’émerger sur la carte du monde : le Somaliland. Il célèbre aujourd’hui sa fête nationale.
Il y a 30 ans, le 18 mai 1991, un nouvel État tentait d’émerger sur la carte du monde : le Somaliland. Quelque mois auparavant, le dictateur somalien Mohamed Siad Barre, avait été renversé. Ce dernier avait jusque-là très brutalement réprimé toute tentative de sécession de cette région du nord du pays. En 1988, Hargeisa, sa capitale, avait été bombardée par l'aviation gouvernementale. La répression fait 50 000 morts et près de 500 000 déplacés (sur un million d’habitants à l’époque)… En janvier 1991, le dictateur était enfin destitué, cet État du nord de la fédération de Somalie, proclamait son indépendance. Depuis, le 18 mai est célébré chaque année comme la fête nationale du Somaliland.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 16 mai 2021
Cette déclaration d’indépendance du Somaliland n’a, cependant, jamais été reconnue par la communauté internationale. Ce qui n’empêche pas des délégations étrangères (djiboutiennes, éthiopiennes, françaises…) de se rendre régulièrement au Somaliland. En mai 2001, l'indépendance a même été entérinée par un référendum qui remporte 97,1 % de oui. Le Somaliland a pourtant un argument : ce territoire était celui d’une colonie anglaise alors que le reste de la Somalie était italien. La reconnaissance d’un Somaliland indépendant ne contredit donc pas la règle sacrée en Afrique qui consiste à ne pas toucher aux frontières issues de la colonisation car cela risquerait de mettre le contient à feu et à sang. D’ailleurs, c’est avec le même argument que l’Érythrée voisine a fini par obtenir son indépendance, reconnue par l’ONU en 1993. Le Somaliland n’a pas eu cette chance. Aujourd’hui, il n’a de relations diplomatiques qu’avec Taïwan, autre exclu important du concert des nations.
Le Somaliland dispose de richesses minières et pétrolières, d’un port important Berbera qui sert aussi de débouché à l’Éthiopie. Mais, faute de reconnaissance, le pays est exclu des circuits financiers mondiaux. Il ne reçoit aucune aide au développement mais n’a aucune dette. Sans moyen financier pour investir dans son économie, le pays de contente pour vivre d’exporter du bétail, près de 5 millions d’animaux sont exportés chaque année dans les pays arabes. Le pays a des administrations qui fonctionnent, financées par la fiscalité (TVA et droits de douane)… Le Somaliland est parmi les plus pauvres d’Afrique. Mais, contrairement au reste de la Somalie, le pays est sûr et croit très fort en son avenir. Somaliland s'en tire en effet bien mieux que la Somalie, toujours en proie au terrorisme islamiste et à un régime autoritaire.
Muse Bihi Abdi, le président de la république du Somaliland depuis 2017
16 mai : le Soudan du Sud célèbre son armée, actrice de deux guerres sanglantes
La Journée de l'APLS (SPLA Day) est un jour férié au Soudan du Sud célébré chaque année le 16 mai. Elle commémore la formation de l'Armée populaire de libération du Soudan (SPLA, Sudan People's Liberation Army)
La Journée de l'APLS (SPLA Day) est un jour férié au Soudan du Sud célébré chaque année le 16 mai. Elle commémore la formation de l'Armée populaire de libération du Soudan (SPLA, Sudan People's Liberation Army)
La SPLA a été formée pendant la guerre civile soudanaise comme mouvement de guérilla. Le 16 mai 1983, un groupe de mutins de l'armée soudanaise a ouvert le feu dans une caserne près de la ville de Bor. Le colonel John Garang de Mabior a été envoyé pour réprimer la rébellion, mais au lieu de cela, il a pris la direction de la SPLA nouvellement formée et a commencé à recruter de nouveaux soldats.
L’origine de cette mutinerie de soldats originaires du Sud-Soudan est la décision du gouvernement du Soudan d’imposer la charia, y compris aux chrétiens vivant au sud du pays. Il a fallu deux décennies à la SPLA pour parvenir à ses fins, c’est-à-dire à la division du Soudan en deux pays distincts. C’est à dire un Soudan du Sud d’abord autonome, puis indépendant. Tout au long de la guerre civile, la SPLA était dirigée par John Garang. Celui-ci est mort en 2005 dans un accident d'hélicoptère alors qu’un accord venait d’être signé avec le gouvernement de Khartoum. Il a été remplacé par Salva Kiir qui deviendra le premier président de la république du Soudan du Sud.
La république du Soudan du Sud a finalement été proclamée en 2011 après un conflit sanglant (deux millions de morts recensés) qui provoqua également le déplacement de quatre millions de civils. L’APLS est devenue l'armée régulière du nouvel État. Le SPLA Day est l’Anniversaire de la Fondation de l’armée de libération populaire du Soudan (APLS).
En réalité, certaines unités rebelles n'ont pas été intégrées à l'armée nationale, d’autres ont fait sécession de l’APLS… un autre conflit presque aussi terrible a débuté en décembre 2013 : une nouvelle guerre civile a ensanglanté le Soudan du Sud jusqu’en février 2020, provoquant 400 000 morts et à nouveau 4 millions de déplacés. La Journée de l’APLS ne fait pas référence à cet épisode encore très récent dans les mémoires.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 15 mai 2021
14 mai : au Liberia, c'est Unification Day
Un jour férié tout à fait de bon aloi dans un pays qui a été ravagé par deux guerres civiles consécutives entre 1989 et 2003.
Ce jour férié décrété par la présidente Elen Johnson Sirleaf en 2010 est tout à fait de bon aloi dans un pays qui a été ravagé par deux guerres civiles consécutives entre 1989 et 2003. La date du 14 mai fait référence à un discours de 1960 prononcé par le président William VS Tubman (1944-1971), lequel était parvenu à réduire l’animosité historique entre l’élite américano-libérienne et les autochtones. Mais celle-ci est devenue explosive trente ans plus tard. Même si le Liberia a aussi subi une terrible épidémie de fièvre Ebola dans les années 2014-2015 – et par chance, la pandémie actuelle de covid-19 le touche peu –, le pays a été plus encore éprouvé par les guerres civiles. Aujourd’hui, les risques politiques liés à son histoire particulière sont toujours latents. Une rechute est toujours possible.
On se souvient que le Liberia a été fondé au XIXe siècle pour des esclaves noirs américains affranchis. Entre 1822 et 1861, des milliers de Noirs libres ont été réinstallés dans la colonie de Cape Mesurado, territoire contrôlé par les Américains. Mais les autochtones, demeurés largement majoritaires, n’ont pas participé à la création de cet État. Ils ont même subi le travail forcé autorisé jusqu’en 1936. Même s’ils ont fini par obtenir le droit de vote, en 1944, ces derniers se sont longtemps considérés comme des citoyens de seconde zone par rapport aux colons et à leurs descendants. Cette division sociopolitique est à l’origine des deux guerres civiles qui ont ravagé le pays.
Un article de l'Almanach international des éditions BiblioMonde, 13 mai 2021